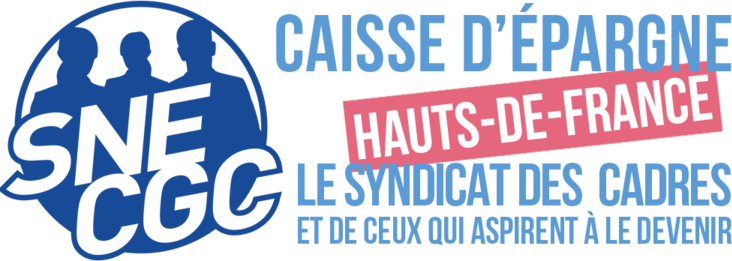Alors que la dette dépasse les 3 300 milliards d'euros, la crainte d'un prélèvement sur l'épargne refait surface dans les discussions publiques.
Cependant, le gouvernement privilégie d'autres options, tandis que, de manière paradoxale, les ménages n'ont jamais autant épargné.
Une préoccupation persistante face à une dette record
La dette publique française a atteint 3 345,8 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2025, représentant environ 114 % du PIB, d'après les données de l'Insee.
Ce niveau ravive, de manière récurrente, une vieille inquiétude : l'État pourrait-il un jour puiser directement dans les dépôts bancaires des Français ?
Cette préoccupation s'est intensifiée cet été, lorsque François Bayrou a présenté son programme d'austérité.
« Notre dette augmente de 5 000 euros chaque seconde », a-t-il averti en juillet, en dévoilant un plan inédit de 43,8 milliards d'euros d'économies pour 2026, visant à ramener le déficit « en dessous de 5 % du PIB dès 2026 ».
Des exemples européens qui alimentent les craintes
L'idée d'une ponction directe peut sembler choquante, mais elle n'est pas sans précédent en Europe.
En Italie, en 1992, le gouvernement Amato avait mis en place un prélèvement exceptionnel de 0,6 % sur tous les dépôts bancaires afin de faire face à une crise budgétaire, alors que la dette italienne frôlait les 120 % du produit intérieur brut.
À Chypre, en 2013, durant la crise bancaire, des prélèvements allant jusqu'à 40 % ont été appliqués sur les dépôts supérieurs à 100 000 € dans certaines banques, pour éviter l'effondrement du système financier.
En Grèce, lors de la crise de 2015, bien qu'il n'y ait pas eu de ponction directe, les retraits étaient limités à quelques dizaines d'euros par jour dans le cadre d'un contrôle strict des capitaux.
Ces événements nourrissent les inquiétudes en France. Cependant, le droit français est clair : il n'autorise pas de telles réquisitions.
L’épargne privée, déjà essentielle au financement public
Contrairement à ces hypothèses extrêmes, l'État français n'a pas besoin de confisquer l'épargne, car il l'utilise déjà par des mécanismes financiers.
Les contrats d'assurance-vie en euros, détenus par 18 millions de personnes, sont investis à plus de 70 % en obligations d'État françaises.
En d'autres termes, chaque épargnant, même sans en avoir conscience, devient créancier de l'État français.
De plus, les livrets réglementés (Livret A, LDDS) sont centralisés à la Caisse des Dépôts, dont une part significative est destinée à financer des logements sociaux et des collectivités locales.
Ainsi, l’épargne privée contribue de manière significative au financement de l'État et du secteur public.
Les véritables marges de manœuvre du gouvernement
Dans ce contexte, la saisie forcée est exclue, à l'exception des cas de contentieux individuels (fraude, impayés) et de la loi Sapin 2, qui permet de suspendre temporairement les retraits sur l'assurance-vie en cas de risque systémique.
En pratique, l'État se concentre sur les leviers fiscaux et sociaux. Cet été, François Bayrou a présenté plusieurs mesures d'économies :
- Suppression de deux jours fériés pour générer 4,2 milliards € de temps travaillé.
- Gel des prestations sociales et des pensions pour économiser 7,1 milliards €.
- Réduction de 3 000 postes publics d'ici 2027, avec un non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois.
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et réduction des niches fiscales.
La position de la CFE-CGC : STOP AUX ATTAQUES CONTRE LES SALARIES, LES CHOMEURS ET LES RETRAITES
Le paradoxe français : peur de la ponction, mais épargne record
Malgré cette inquiétude, les ménages épargnent plus que jamais. Au deuxième trimestre 2025, le taux d’épargne a atteint 18,9 % du revenu disponible brut, un niveau inédit depuis les années 1980 (hors période Covid).
Ce paradoxe révèle un climat de défiance : face à des craintes concernant l’avenir (inflation, réformes budgétaires, instabilité), les Français adoptent une attitude plus prudente. L’épargne, loin d'indiquer une confiance, traduit une inquiétude persistante.
Un risque politique plus que financier
En résumé, l'idée d'une réquisition directe des avoirs bancaires est plus imaginaire que réelle.
Cependant, la dette est bien réelle et ses conséquences toucheront les ménages. En France, la « contribution » des épargnants se traduira par des réformes fiscales, sociales et budgétaires, plutôt que par une confiscation brutale.
La question n'est donc pas de savoir si l'État va directement « prendre » l'épargne des Français, mais plutôt jusqu'où il devra ajuster ses dépenses, ses recettes fiscales et le niveau des prestations sociales pour réduire le déficit et maîtriser la dette.